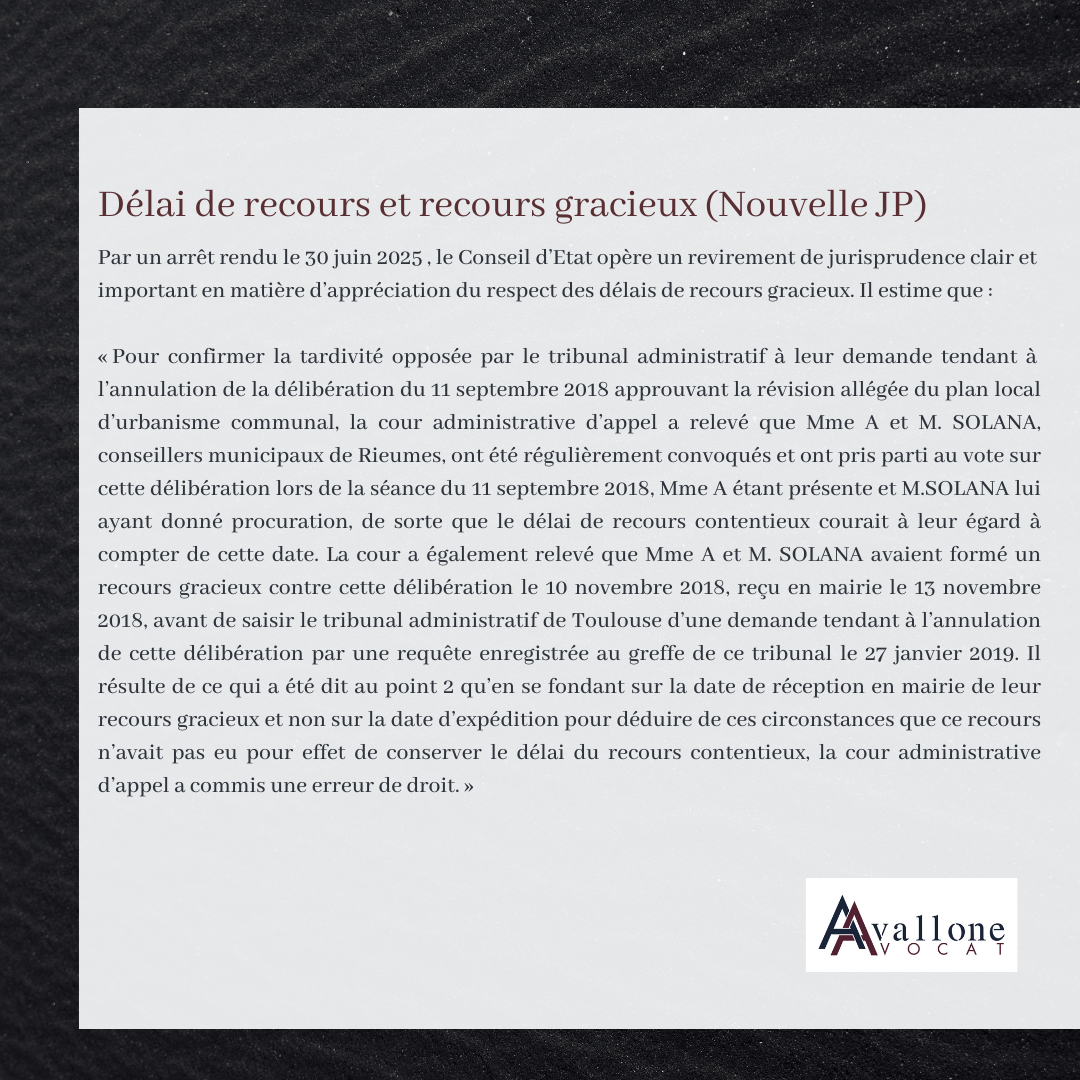Droits à l’avancement des fonctionnaires exerçant une activité durant une période de disponibilité
Le 27 mars dernier, le décret n° 2019-234 a mis en œuvre les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permettant aux fonctionnaires désireux d’exercer une activité privée pendant une période de disponibilité de conserver leurs droits à avancement durant cinq ans.
Ce décret ayant pour objet, d’une part, d’organiser le maintien des droits à l'avancement des fonctionnaires exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité, et, d’autre part, de modifier le régime de la disponibilité pour convenances personnelles, concerne les trois piliers de la fonction publique à la fois: étatique, territoriale et hospitalière.
L’article 109 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 est venu modifier l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et concerne les activités professionnelles exercées pendant la disponibilité́. En principe, le fonctionnaire placé en disponibilité́ cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Ce principe connaît désormais une dérogation: lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité́ au cours de laquelle il exerce une activité́ professionnelle, il conserve, dans la limite de cinq ans, ses droits à l’avancement. De telles dispositions sont applicables aux disponibilités et aux renouvellements de disponibilitéś prenant effet à compter du 7 septembre 2018.The bod
Ainsi, à condition qu’un agent, au cours d’une période de disponibilité, exerce une activité professionnelle, il pourra bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, de ses droits à l’avancement d’échelon et de grade. De fait, cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois. La prise en compte de ces activités professionnelles dans le cadre d’une promotion à un grade à accès fonctionnel sera également envisageable. Pour ce faire, le fonctionnaire en disponibilité est tenu de transmettre à son administration une liste de pièces, fixée par arrêté, attestant de cette activité, au plus tard le 31 mai de chaque année. Quoi qu’il en soit, la durée de la disponibilité ne pourra excéder cinq ans, mais sera toutefois renouvelable une fois si, à l’issue de la première période de cinq ans, le fonctionnaire est réintégré pendant une durée d’« au moins 18 mois » dans la fonction publique.
La notion d’activité professionnelle est entendue largement, au sens de l’article 5 du décret, comme « toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel » qui correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an pour un salarié ou qui procure un revenu au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres de retraite pour un indépendant. Les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l'avancement sont fixées par l'article 7 du décret du 27 mars 2019.
Certains n’ont pas manqué de soulever divers problèmes qui pourraient se poser notamment dans les collectivités territoriales:
Puisqu’un fonctionnaire en disponibilité est désormais contraint de revenir dans sa commune ou son EPCI d’origine pendant 8 mois réglementaires avant de repartir pour une nouvelle période de 5 ans, il est nécessaire qu’un poste soit disponible pour lui à ce moment; dans le cas contraire, la collectivité devra lui verser une allocation chômage avant qu’un poste correspondant à son grade soit vacant, ce qui représentera évidemment une charge financière.
D’autres encore se sont étonnés du fait que le dispositif instauré par le décret soit circonscrit à des activités lucratives, et pas étendu à l’exercice d’un mandat électif local, poussant les fonctionnaires à se tourner vers la solution du détachement, la disponibilité́ de plein droit pour exercer un mandat local, la disponibilité́ d’office pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou du parlement européen ainsi que la disponibilité́ d’office quel que soit le motif n’entrant pas dans le champ du maintien des droits à l’avancement.y
Enfin, lors de l’examen du texte au Parlement, nombre de sénateurs avaient critiqué le dispositif l’accusant de « faciliter le pantouflage », en établissant une inadmissible « équivalence entre le service de l’intérêt public et celui de l’intérêt privé »
Extrait de la Newsletter éditée en partenariat avec l'Association des Anciens Elèves des IRA