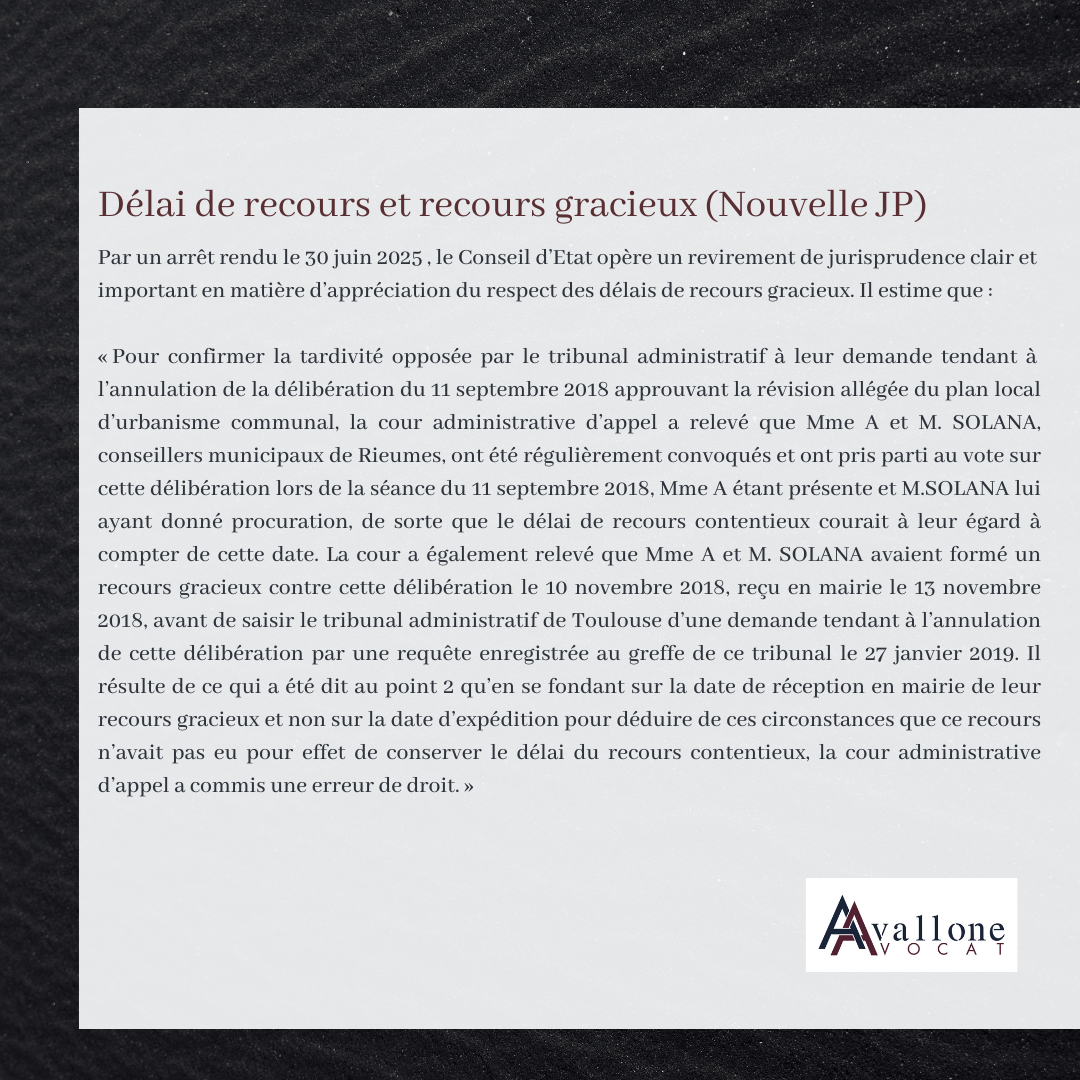Précision sur la notion d'urbanisation continue en zone montagne
Précision sur la notion de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant » permettant l’urbanisation continue en zone de montagne
CE 2 octobre 2019, req. n° 418666 : mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Dans cette affaire le maire de la commune du Broc a délivré par arrêtés de juin et juillet 2013, deux permis de construire pour une première maison d’habitation et une seconde avec piscine en secteur NB du plan d’occupation des sols, zone naturelle dans laquelle il est admis le « confortement (…) des groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » par la carte 19 de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes.
Les deux décisions ont été déférées au TA de Nice qui a rejeté les demandes. Par un arrêt du 28 décembre 2017, la CAA de Marseille a annulé le jugement ainsi que les deux arrêtés attaqués en estimant que le principe de continuité n’était pas respecté sur le fondement de L.145-3 (ancien) du code de l’urbanisme.
La commune du Broc et la SCI la Clave ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation en l’annulation de l’arrêt rendu par la CAA de Marseille.
- Pour mémoire, s’agissant des règles applicables en zone de montagne
L’article L.122-5 (à la suite de l’ancien article L.145-3) du code de l’urbanisme dispose :
« L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »
L’article L.122-5-1 du code de l’urbanisme dispose par ailleurs :
« Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. »
En jurisprudence,
Il est considéré qu’une parcelle exploitée en fermage loin du bourg ne répond pas à l'urbanisation en continuité, malgré la proximité de quelques constructions dispersées. Elle ne saurait donc être classée en zone U. (En ce sens :
CE 9 juill. 1997, Morand, no 123341: Lebon T. 1114)
Si le terrain considéré ne se situe pas en continuité de l'existant, peu importe qu'il soit desservi en électricité et dispose d'un accès. (En ce sens :
TA Nice, 28 juin 2001, Pons c/ Préfet des Alpes-Maritimes, no 98879.)
Un tel terrain est inconstructible même s'il est desservi en eau potable, électricité et voirie et s'il est classé en zone urbaine. (En ce sens :
TA Nice, 8 mars 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Cne de Saint-Vallier-de-Thiey, no 004625)
Même six constructions implantées sur des parcelles contiguës, mais non groupées ne sauraient constituer une urbanisation suffisante.
En ce sens :
CE 5 février 2001 Secrétaire d’Etat au logement / Commune de Saint Gervais n°217796
En outre, parmi les objectifs de la loi montagne figure la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
Ainsi, il a pu être jugé que le projet d’un parc de stationnement est de nature à altérer un paysage de montagne dont l’aspect sauvage fait tout la beauté. (En ce sens :
TA Nice, 8 novembre 1988 Epoux Blot n°116788-II)
De même, l’aménagement de courts de tennis, même en nombre limité, ou de piscines, même de faibles dimensions et la construction de locaux indispensables au fonctionnement des activités sportive et de loisirs sont de nature à porter atteinte à cette objectif.
En ce sens :
CE 20 septembre 1991 n°76539
- Le rappel classique du principe de continuité en zone de montagne
À l’occasion de cet arrêt, le Conseil d’Etat vient d’abord rappeler brièvement l’exigence classique du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, en citant explicitement les dispositions de l’article L.145-3 de l’urbanisme, désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code :
« Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. »
Le Conseil d’Etat confirme également qu’il incombe à l’autorité administrative chargée d’instruire la demande de vérifier la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la loi montagne. Elle ne pourra donc, sans surprise, autoriser un projet en zone d’urbanisation diffuse mais seulement en continuité de l’urbanisation existante.
- Précision utile sur la notion de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant »
L’apport de cet arrêt tient surtout de la précision apportée à la notion de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » au sens de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme (aujourd’hui codifié aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code).
Le Conseil d’Etat précise qu’
« il résulte des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existant " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. »
Le Conseil d’Etat opère une distinction entre d’une part « les bourgs, villages et hameaux existants » qui sont identifiables sans difficultés, et d’autre par les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes » pour lesquelles il donne des indications pour en faciliter la caractérisation.
Pour déterminer si un groupe d’habitations peut être qualifié de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant », le Conseil d’Etat dégage le faisceau d’indices suivant, en affirmant qu’il convient de vérifier l’existence de :
- Plusieurs constructions
- Leurs caractéristiques
- Leur implantation les unes par rapport aux autres
- L’existence de voies et de réseaux
Ces critères permettent alors de percevoir l’appartenance des constructions à un même ensemble.
Cette décision publiée au Lebon permet d’apprécier plus particulièrement le « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant » en se concentrant sur la qualification des « habitations existantes ».
Ainsi, l’édification de constructions nouvelles en zone de montagne est possible en continuité d’un groupe de constructions, lorsque ce dernier répond au faisceau d’indice dégagé dans cet arrêt. En précisant sa jurisprudence, le Conseil d’Etat rend plus lisible la notion de construction en continuité de l’urbanisation existante en zone de montagne.
En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en se fondant sur les critères qu’il vient de dégager, et affirmer que les constructions envisagées ne sauraient être regardées comme respectant le principe de continuité en ce que « les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement ».
Sébastien Avallone et Garance Carbonne